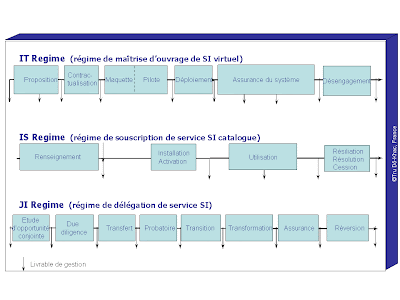Jusqu’à présent, la notion de régime de gouvernance informatique («
IT governance regime »)est très rarement utilisée dans la littérature en gestion de système d’information, à l’opposé des formules telles que cadre de gouvernance («
governance framework ») ou modèle de gouvernance («
governance model ») ;
en sus, c’est le terme archétype de gouvernance («
governance archetype ») qui est utilisé notamment par le professeur Peter Weill et Richard Woodham du MIT pour désigner «
IT monarchy », «
Business Monarchy », «
Federal », ou «
Feudal » [1]. On peut s’en étonner car ces éléments désignent précisément des régimes politiques.
Outre son intérêt de proposer une typologie de régimes de gouvernance de SI, l’approche du MIT montre que l’ «
IT governance » est plus une affaire de gouvernance
pour les systèmes d’information qu’une gouvernance
de systèmes d’information.
Pour notre part, nous pensons qu’une ontologie [nldr représentation] de la gouvernance informatique doit trouver ses sources dans les sciences politiques.
Dès lors, nous avons repris à notre compte la notion de régime et défini la gouvernance comme la «
définition, l’application et le management de régime(s) de gouvernance » [2] (definition, application and management of IT governance regime(s)).
Cette actualisation de la gouvernance en un régime ouvre de nombreuses portes sur le plan de la pratique :
- tout d’abord, on identifie le livrable d’un projet de gouvernance de SI : c’est le régime de gouvernance de SI.
- ensuite, on est amené à mettre en place des mesures pour gérer le cycle de vie d’un régime.
- enfin, en plaçant la notion de régime au centre de la gouvernance de SI, on avance que la gouvernance est plus une affaire de relations entre partie prenante qu’une affaire de processus.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] Don’t just lead: govern. Implementing effective IT governance, Peter Weill, Richard Woodham, 2002, MIT CISR.
[2] eSourcing Governance Thesaurus, Tru Dô-Khac, séminaire, Mastère Mines HEC Management des Systèmes d’Information et de Technologies MSIT, janvier 2009.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------